Faits divers
The American Five, de Charles Ives à Henry Cowell

Tout le monde connaît le Groupe des Cinq (russes), Modeste Moussorgski (1839-1881), Nikolaï Rimski-Korsakov (1844-1908), Mili Balakirev (1837-1910), César Cui (1835-1918) et Alexandre Borodine (1833-1887), dans cet ordre, de gauche à droite, sur la photographie ci-contre (Trouvez et, plus difficile, identifiez l'intrus, réponse en bas de page). Ils sont tous passés à la postérité, un peu moins Cui pourtant le chef de file et théoricien du groupe. Ensemble, ils prônèrent une musique spécifiquement nationale, basée sur les traditions populaires et détachée des standards occidentaux, incarnés par Pyotr Ilyich Tchaïkovsky (1840-1893), auxquels ils préféraient l'idéal de Mikhaïl Glinka (1804-1857). Largement autodidactes (?), en tous cas autoproclamés tels, ils bénéficièrent, de fait, de l'aide du seul véritable professionnel de la bande (Rimski-Korsakov) qui (ré)orchestra plusieurs de leurs partitions même après leur mort.

Beaucoup connaissent l'éphémère (1916-1923) Groupe des Six (Franco-Suisse), Darius Milhaud (1892-1974), Georges Auric (1899-1983), Arthur Honegger (1892-1955), Germaine Tailleferre (1892-1983), Francis Poulenc (1899-1963) et Louis Durey (1888-1979) (Trouvez et, très facile, identifiez l'intrus sur la photographie, réponse en bas de page). Leur credo musical, hérité des théories d'Erik Satie, se situait à égales distances du wagnérisme et de l'impressionnisme ambiants. L'histoire a réservé des sorts très différents à ces musiciens, privilégiant Honegger, Milhaud et - surtout Outre-Atlantique où il est une star - Poulenc, au détriment de Tailleferre, Auric et Durey.
Le Groupe des Cinq (américains) est beaucoup moins connu d'où l'intérêt de cette incursion dans le monde de la musique américaine naissante. Il s'est constitué autour de Carl Ruggles (1876-1971), John Becker (1886-1961), Wallingford Riegger (1885-1961) et Henry Cowell (1897-1965), quatre musiciens ultra modernistes ayant revendiqué l'héritage de leur contemporain, Charles Ives (1874-1954). Leur intention était de composer une musique en rupture avec les traditions classiques européennes, un objectif qu'avec le recul on comprend d'autant moins qu'à cette époque, la musique du continent partait dans toutes les directions. Aujourd'hui, seuls Ives et Cowell ont gardé un (encore trop) modeste pignon sur rue et cette chronique est avant tout l'occasion de leur rendre un hommage sincère.
Le Maître ...

Charles Ives est l'un des pères fondateurs de la musique moderne, il n'est pas utile d'ajouter américaine. Il incarne l'essence même du miracle américain, celui qui autorise toutes les initiatives sans autre critère - a posteriori - que celui de la réussite. Son père, George Ives, chef de musique militaire dans l'armée des États-Unis durant la guerre de Sécession, l'a très tôt initié aux pratiques musicales les moins orthodoxes, comme faire de la musique avec tout ce qui lui tombait sous la main ou chanter en famille, à plusieurs voix dans des tonalités différentes (Charles se souviendra régulièrement du procédé, notamment lorsqu'il écrira, pendant ses études, une fugue à 4 voix, notées avec des clés distinctes). Malgré un goût certain pour l'expérimentation, Ives fils n'a cependant jamais oublié ce conseil parternel : "Fais ce que tu veux mais fais-le bien".
Son premier coup de maître, l'adorable Symphonie n°1 (Part 1, Part 2, Part 3, Part 4), fut son travail de fin d'études: c'est une oeuvre naïve mais touchante, pas moderne pour un sou mais ce n'était pas ce que son professeur, le réputé Horatio Parker (1863-1919), attendait de lui (Ecoutez le début de la Nothern Ballad de ce dernier et vous comprendrez).
Assureur professionnel, Ives ne fut musicien qu'à ses heures perdues : il n'en fallait pas plus pour des puristes dénigrent l'art de ce pionnier amateur. Stravinsky l'appréciait cependant, montrant en exemple sa New England Holydays Symphony (Washington's Birthday, Decoration Day, The Fourth of July, Thanksgiving and Forefathers' Day). Travailleur infatigable, les week-ends passés à écrire lui suffirent pour étoffer un catalogue où l'on trouve de tout :
- une bonne centaine de songs plus ou moins réminiscents d'airs populaires (Songs My Mother Taught Me, Evening, Two Little Flowers),
- des hymnes, religieux - souvenir des heures passées comme organiste d'église (Psaume 90) - ou profanes - on lui doit les hétéroclites Variations on America (1891), célébrant le centenaire de la Déclaration d'indépendance des Etats-Unis (Il existe une version orchestrale de cette pièce, due à William Schumann).
- des musiques qui s'entrecroisent sans redouter de se marcher sur les pieds (From the Steeples and the Mountains, Symphonie n°4, 2ème mouvement),
- un postmodernisme planant 50 ans avant la lettre, comme dans ce tube atmosphérique, The unanswered Question, où une trompette plaintive cherche un peu de réconfort auprès d'un ensemble à cordes, une rencontre à peine perturbée par l'intrusion tardive d'un quatuor de flûtes.
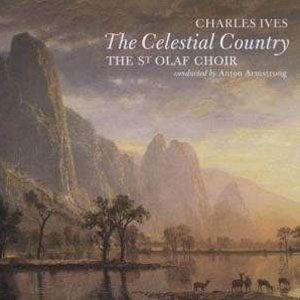
Outre la 1ère Symphonie, déjà évoquée, vous devriez prendre plaisir à entendre les trois autres, n°2, n°3 (dont le 3ème mouvement The Fourth of July propose un bel exemple de charivari ivesien) et n°4, celle-ci la plus ambitieuse de toutes, pour orgue, piano, percussions, choeur & orchestre. Si cette symphonie passe pour son chef-d'oeuvre, je ne peux décidément pas passer sous silence The celestial Country (Part 1 & 2, Part 3, Part 4 & 5, Part 6 & 7), une oeuvre accessible que j'aime particulièrement pour l'originalité de sa conception.
La Sonate pour piano n°2, Concord, fait partie des sommets pianistiques au 20ème siècle (Marc-André Hamelin l'a enregistrée, un must absolu mais accrochez-vous quand même !).
Quelques oeuvres de musique de chambre cultivent des moments de plus grande intimité, un austère Trio à clavier, deux quatuors (Quatuor à cordes n°2, mêlant dissonance et contrepoint) et 4 Sonates pour violon & piano (n°1, n°2, n°3, n°4).
Vers la fin des années 1920, tout comme Jean Sibelius à peu près à la même époque, Ives fut frappé d'une panne définitive d'inspiration. Il lui restait pourtant 25 ans à vivre (de ses rentes d'assureur) pendant lesquelles il se contenta de reviser des partitions antérieures. Deux oeuvres ambitieuses demeurèrent ainsi en éternel chantier : un Concerto pour piano (Emerson), complété ultérieurement par David Porter au départ d'esquisses substantielles et une 5ème Symphonie, baptisée rien moins qu'Univers. Ives tenait particulièrement à cette oeuvre utopique qu'il a portée pendant 40 ans (1911-1951), cherchant désespérément à en fixer le programme autour d'une thématique mêlant le passé (genèse des océans et des montagnes), le présent (terre, évolution de la nature et de l'humanité) et le futur (ciel, la montée vers le spirituel) et prévoyant une décomposition spatiale entre deux orchestres ou plus. Voyant qu'il n'aboutissait à rien de concluant, il a proposé à Henry Cowell d'achever l'oeuvre mais celui-ci a décliné l'offre la jugeant problématique. Plus récemment, quelques musiciens ont tenté l'aventure, sur base des 49 pages d'esquisses existantes, Larry Austin, Michael Stern et Johnny Reinhard (téléchargez gratuitement les extraits au format mp3).
Bien que passionné par son art, Ives ne s'est jamais vraiment pris au sérieux, négligeant en particulier de publier ses partitions. Il n'acquit la notoriété que tardivement lorsque l'avant-garde new-yorkaise redécouvrit son oeuvre alors qu'il avait cessé d'écrire depuis près de 20 ans ! En 1947, sa troisième symphonie (achevée en 1904 !) obtint le Prix Pulitzer. Quant à la Quatrième, elle ne sera jouée intégralement que 11 ans après sa mort.
... et les disciples

Carl Ruggles (1876-1971) fait partie de ces musiciens qui hantent davantage les histoires de la musique que les salles de concerts ou d'enregistrement. Il fut en grande partie l'artisan de ce malentendu : n'écrivant que par essai et erreur, il a détruit nombre de partitions de jeunesse d'allures postromantiques, réduisant son catalogue à une douzaine de pièces dont la radicale modernité - une variante assouplie du sérialisme schönbergien (Toys) - a trouvé grâce à ses oreilles. Les théoriciens de la musique américaine se sont par contre abondamment penché sur son contrepoint dissonant ainsi que le qualifia Charles Seeger, le mari de Ruth Crawford, évoquée lors d'une chronique antérieure.
La réputation de l'homme a également pâti de son mauvais caractère teinté de racisme militant. Sa passion pour la peinture qu'il pratiquait plus assidûment que la musique (des centaines de tableaux mais je ne peux en proposer aucun !) ont achevé de mettre un frein à sa notoriété comme compositeur.
Michael Tilson Thomas a honoré la musique symphonique de Ruggles comme il l'avait fait pour celle de Ives, l'enregistrant intégralement avec le Buffalo Philharmonic Ochestra. C'est à son initiative qu'on doit de connaître aujourd'hui Sun-treader, une oeuvre qui a fait fortune auprès des analystes pour les structures fractales que dessine la succession des hauteurs de sons. Organum, Men and Mountains sont deux autres partitions de valeur, écrites pour grand orchestre.

Wallingford Riegger (1885-1961) fut beaucoup plus prolifique que Ruggles. Violoncelliste de formation, il a voyagé entre les USA et l'Allemagne jusqu'à ce que la première guerre le convainque de rentrer définitivement au pays. Il y a dès lors partagé son temps entre l'enseignement et la composition rencontrant l'approbation de Leonard Bernstein qui dirigea sa musique avec "son" New York Philharmonic Orchestra.
Bien qu'il ait compté parmi les premiers américains à adopter un dodécaphonisme libre, une part non négligeable de son catalogue est de coupe nettement traditionnelle. C'est, sans surprise, cette composante de son oeuvre qui a été enregistrée (Sinfonietta, Variations pour piano & orchestre, opus 54, Variations pour violon & orchestre, opus 71, Music for orchestra, opus 50, Symphonie n°4). Dance Rhythms est même une oeuvre plaisante et légère. La musique de Riegger n'est pas toujours facile d'accès mais elle mérite toute votre attention. L'artiste est mort stupidement d'un traumatisme crânien après s'être pris les pieds dans les laisses de deux molosses.

John Joseph Becker (1886-1961) est le moins connu de la bande ce qui n'est pas peu dire. On ne possède que peu d'enregistrements de ses oeuvres et pourtant il a écrit des symphonies - la plus "connue" est la Symphonia Brevis (1931) -, des concertos et des oeuvres chorales d'inspiration religieuse. Sound piece n°1, une belle pièce pour piano et orchestre de chambre, a malheureusement disparu des catalogues. The Abongo et Vigilante sont deux danses primitives pour percussions qui témoignent de la mode du temps pour les nouveaux rythmes et sonorités que ce type d'instrumentation permettait. A Marriage with Space (1935) passe pour une oeuvre scénique ambitieuse - du moins pour l'époque -, préoccupée d'intégrer tous les éléments du spectacle, pas seulement musicaux. Il n'y a pas grand monde aujourd'hui pour pouvoir témoigner de la réussite de l'entreprise. Au bilan Becker, a laissé davantage de traces au sein de la vie musicale américaine, s'étant investi comme Henry Cowell dans la promotion et la publication de la musique moderne de son pays.

Henry Cowell (1897-1965) fut le plus jeune et le plus versatile du groupe, ayant emprunté à tous les styles, des plus modernes aux plus conservateurs. Cette disparité stylistique particulièrement extrême fut la conséquence d'une histoire personnelle dramatique.
Clarissa Belknap Dixon, une écrivaine très tôt engagée dans le mouvement féministe américain (Janet and Her Dear Phebe), a mis Henry Cowell au monde à l'âge inhabituel de 45 ans. Elle l'a pratiquement élevé seule, à partir de 1903, l'année de son divorce avec Harry Cowell, lui aussi écrivain. Henry est cependant resté en contact avec son père, qui lui a enseigné la valeur de la musique populaire irlandaise, chère à ses ancêtres. Il n'a jamais oublié cette leçon même dans ses oeuvres plus avancées (3 Légendes irlandaises (1922), Irish Jig (1925)).
Cowell était génétiquement programmé pour la modernité et, très jeune, il a écrit des pièces ne ressemblant à rien de connu, telle Anger Dance (1914), une oeuvrette minimaliste bien avant la lettre.
Admis à l'Université de Berkeley, il y étudia sous la direction de l'incontournable Charles Seeger puis il poursuivit ses études à New York où il rencontra Leo Ornstein l'un des précurseurs de la modernité aux USA. Ce fut le véritable point de départ de son exploration personnelle :
- Cowell fut un pionnier dans le domaine de la percussion : Return et Pulse (1939) sont, à cet égard, des réussites incontestables, à découvrir !
- Le compositeur a ensuite durci son attitude, explorant le pouvoir d'impact des agrégats sonores (clusters) résultant des sollicitations les plus insolites du clavier. Le "petit" Concerto pour piano & orchestre de 1928 illustre cette tendance avec ses trois mouvements aux titres évocateurs (Polyharmony, Tone Cluster et Counter Rhythm). Ne confondez pas cette oeuvre avec le plus tardif Concerto Piccolo (1941) qui oppose un piano encore aventureux à un orchestre doucereux sur fond d'airs irlandais. Au piano solo, Dynamic Motion (1916), Tiger (1928) ou Ostinato pianissimo sont autant de merveilles de concision. Cowell qui jouait ses propres oeuvres s'est ainsi taillé une belle réputation d'interprète au point que Schönberg ait sollicité qu'il se fasse l'interprète de ses propres oeuvres. On a conservé peu de témoignages de son jeu mis à part un enregistrement, publié en 1963 (20 Pièces, Fabric).
-
Dans ses premières musiques de chambre (1915-17), tels les Quatuors Romantic, Pedantic et Euphometric, Cowell a encore innové avec ce qu'il a appellé "l'harmonie rythmique", où chaque ligne mélodique suit son propre rythme. La Sinfonietta de 1928 renouera avec ce procédé, ce qui le mènera, en 1930, à commander le Rythmicon - la première boîte à rythmes de l'histoire de la musique - à l'inventeur russe, Léon Theremine (1896-1993). Pour rappel, Theremine est aussi le nom d'une autre invention présentée à Lénine, en 1919 : elle se joue avec les mains qui voltigent sans jamais toucher l'instrument qui est de fait électromagnétique. Un temps oublié, l'instrument a connu une seconde jeunesse lorsque nombre de musiciens pop l'ont remis à l'honneur (Bee Gees, Beach Boys, Rolling Stones, Jean-Michel Jarre, ...).

Le rythmicon - Au clavier, Cowell a poursuivi son approche radicale de la composition, avec des pièces qui demeurent le cœur de sa production : Banshee (1925) et Aeolian Harp (1923) sont autant d'oeuvres fascinantes reposant sur une sollicitation directe des cordes du piano (Pincements, balayages et grattages, comparez avec cette interprétation très différente de Daniele Lombardi). Le (futur !) piano préparé de John Cage (1912-1992) paraît bien pauvre à côté de celui de Cowell.
- Dans les années 1930, Cowell s'est intéressé à la musique à caractère aléatoire (Anger Dance, Quatuor Mosaïque (Quatuor à cordes n°3) mais il n'a guère eu le temps de persévérer dans cette voie car sa vie a basculé (cf infra).
Le catalogue de Cowell propose encore quantité d'oeuvres inclassables : si le Quatuor à cordes n°2 (1928) vous rebutera peut-être, Tides of Manaunaun (1917), une oeuvre figurant au répertoire de maints pianistes, pourrait vous réconcilier avec le musicien.
L'univers des tardives 16 symphonies (n°4, n°5, n°7, n°11, n°15, n°16) est, à mon avis, moins intéressant, le compositeur ayant adopté des formes de plus en plus conventionnelles débouchant sur une musique descriptive à la sauce nordique, l'âpreté en moins. Vous devriez apprécier davantage les très belles Variations pour orchestre (1956), l'orientalisant Persian Set (1957), les Variations on Thirds (1960) ou la Sonate n°1 pour piano & violon (1945). La cassure stylistique globalement observable entre les oeuvres du début et de la fin de la vie du compositeur trouve sans doute son explication dans les événements relatés ci-après, qui ont fortement altéré la trajectoire musicale de Cowell.
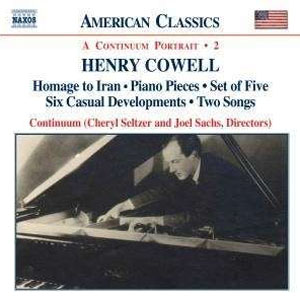
Cowell était bisexuel. Condamné à 10 ans de prison pour détournement d'un mineur de 17 ans, sa peine fut réduite à 4 ans grâce à l'intervention de quelques personnalités du monde artistique, tel John Cage. En prison, Cowell demeura musicalement actif mais sa libération, en 1940, sous la promesse de "bonne conduite", altéra définitivement sa propension à l'audace, naturelle jusque-là. Il déménagea de fait sur la Côte Est, se mariant et n'écrivant plus qu'une musique relativement rangée ce qui ne signifie pas forcément qu'elle ait perdu tout intérêt. Les emprunts à la musique populaire devinrent nettement plus littéraux (18 Hymnes et Fuguing Tunes : n°9 & n°10), s'abstenant des détournements iconoclastes de la première période. Seules quelques évocations de musiques extrême-orientales surprirent encore, Ongaku, aux accents japonais (1957), la Symphonie n°13, "Madras" (1956-58) (dont la première eut lieu dans la ville du même nom) et Hommage to Iran (1959).
On trouve encore, à la même époque, des oeuvres simplement soucieuses de plaire tel cet insouciant Quatuor pour flûte, hautbois, violoncelle & harpe (1962) ou cette musique qu'on peut qualifier de légère, Saturday Night at the Firehouse (1948).

Cowell n'a jamais tenu rigueur à Ives de s'être éloigné de lui lorsqu'il fut inquiété par la justice : il fut le premier à lui consacrer une étude documentée, toujours d'actualité, en collaboration avec sa femme, Sidney Hawkins Robertson.
Assagi dans ses dernières années, Cowell a produit quelques nouvelles œuvres impressionnantes par leur individualité, telles les 26 Simultaneous Mosaics (1963), qui renouent avec une forme de modernité.
Réponses aux questions posées en entrée : chez les russes, l'intrus est le redouté critique d'art, Vladimir Stasov, assis au centre et se tenant de profil; chez les français, il s'agit évidemment de Jean Cocteau (assis au clavier). L'un et l'autre posent en tant qu'instigateurs inconditionnels de "leur" groupe.