Faits divers
Einstein on the Beach : le premier "audiopéra"
L'opéra ambitionne d'être l'art total par excellence, à l'intersection de la musique, de la danse, du théâtre et de tous les procédés liés à la dramaturgie (décors, costumes, accessoires, éclairages, etc ...). Précisons que peu d'œuvres atteignent réellement cet idéal : à part les derniers opéras de Mozart, ceux de Richard Wagner et de Richard Strauss, plus quelques chefs-d'œuvre isolés (Boris Godounov, Carmen, Othello, …), un grand nombre d'oeuvres sont malheureusement plombées par un livret inconsistant. Notons que cela n'a pas pour autant nui à leur "carrière" car, pour beaucoup de mélomanes, c'est essentiellement le chant qui confère son attrait à l'opéra. Si les amateurs ne se lassent pas d'assister aux représentations d'Il Trovatore, ce n'est certes pas pour réentendre l'histoire débile qui leur est contée, mais bien les airs de bravoure servis chaque fois par des voix différentes.
Il ne faut pas chercher ailleurs l'explication de ce fait fondamentalement étrange que les maisons d'opéra vivent d'un répertoire exigu qu'elles ne cherchent pas à renouveler autant qu'il le faudrait.
Le pouvoir d'émotion que la voix chantée exerce sur tous les publics sensibles est maximum lorsque celle-ci parvient aux auditeurs sans artifice. Aux siècles précédents - et pour cause - on n'aurait pas imaginé amplifier les voix par quelque procédé que ce soit. C'est chose plus courante aujourd'hui, dans les stades évidemment, mais aussi dans des lieux plus feutrés : bien qu'elle s'en défende, l'immense salle du MET new-yorkais (4000 places !) y aurait discrètement recours mais chut, le sujet est tabou.
La fin du 20ème siècle a vu l'avènement d'un genre opératique nouveau où les nouvelles technologies, audio et vidéo, occupent une place centrale. Certes il y a longtemps que les metteurs en scène ont recours à des procédés visuels s'appuyant sur les techniques les plus récentes et on ne doute pas que la 3D fera bientôt partie intégrante de leur arsenal. Toutefois l'"audiopéra" dont il veut être question ici est d'un genre différent, où la sonorisation occupe une place centrale : les voix sont volontairement amplifiées de même que les instruments qui les accompagnent, des synthétiseurs voire des cordes ou des bois électriques.

La grande salle de l'Opéra Berlioz à Montpellier vient d'être le théâtre d'un événement rare qui n'est plus appelé à se reproduire : la recréation en présence des co-auteurs du mythique Einstein on the Beach, créé au Festival d'Avignon, en 1976. Ne pouvant manquer l'événement, je me suis déplacé pour vous servir ce compte-rendu enthousiaste. Précisons que cette nouvelle production est appelée à voyager, notamment à Londres et à Amsterdam. (Note ajoutée : Paris était primitivement absente de cette tournée. Pour de mauvaises raisons (financières), la capitale française avait renoncé à représenter Einstein sur ses terres, et ce fut précisément la chance de Montpellier, trop heureuse de sauter sur l'occasion. Il ne lui a pas fallu longtemps pour mesurer l'ampleur de son erreur et, de fait, le théâtre du Chatelet a rectifié le tir deux ans plus tard. La représentation a été filmée pour Mezzo dans d'excellentes conditions, vous seriez impardonnable d'ignorer le DVD).
Einstein on the Beach est né d'une volonté collective de décloisonner les genres de l'opéra, de la danse et du théâtre : Bob Wilson, pour la mise en scène, Philip Glass pour la musique et les chorégraphes Andy Degroat (pour les ensembles) et Lucinda Childs (pour les solos), ont travaillé sur un projet global commun. Il s'agissait non de reproduire le schéma classique d'une histoire contée de A à Z mais plutôt de rassembler sur une même scène des actions isolées comme autant de pièces d'un puzzle jamais assemblé, sauf par les spectateurs qui sont invités à faire leur part de travail. Le livret sur lequel l'oeuvre est construite ne raconte aucune histoire et d'ailleurs ce n'est pas un livret : ses paroles ne sont pas porteuses de sens, ce n'est pas leur rôle, c'est l'oeuvre toute entière qui leur donne le sens que votre imaginaire voudra leur donner; là réside la force de ce spectacle inépuisable. Se perdre dans Einstein est non seulement probable mais nécessaire. De l'aveu même de Bob Wilson, en conférence à Montpellier, l'idée était de donner raison à Malraux regrettant que la littérature ait peu à peu phagocyté le théâtre (lyrique).

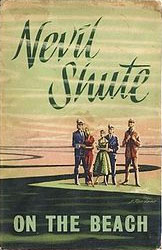
L'oeuvre porte un titre étrange. Précisons qu'il ne faut pas en chercher l'origine dans l'album de famille de l'illustre physicien. "On the Beach" est le titre d'une nouvelle d'anticipation du romancier anglo-australien, Nevil Shute (1899-1960), qui évoque le désastre consécutif à une troisième guerre mondiale ayant fait l'usage de l'arme atomique. L'allusion au rôle joué par Einstein dans la mise au point de cette arme, dès 1939, est claire mais précisons que l'opéra n'y fait pas explicitement référence.
Le temps recomposé est un élément fondamental d'Einstein et non pas le résultat de l'évolution d'une histoire qui en commanderait le déroulement. Les scènes hermétiques se succèdent, évoquant en alternance un train (A, celui qui servait de modèle à Einstein pour vulgariser l'idée de relativité du temps ?), un procès (B, celui d'Einstein ?) et un vaisseau spatial (C, l'incarnation de l'exploration de l'univers) : chaque élément peut être rattaché à la biographique du savant mais rien n'est sûr ni d'ailleurs imposé au spectateur. Wilson a découpé le projet selon la trame, AB (Acte 1), CA (Acte 2), BC (Acte3) et ABC (Acte 4). On notera la similitude avec la découpe des formes classiques (forme sonate, ABA, etc ... ). Des interludes dansés (knee plays) assurent la jonction entre les actes, permettant aux spectateurs engourdis ou tiraillés d'un besoin pressant de quitter la salle (l'oeuvre dure 285 minutes, sans interruptions !). Par bonheur, à Montpellier, les spectateurs hypnotisés n'(ab)usèrent pas de cette liberté.
Que reste-t-il aujourd'hui de la synergie primitive : doit-on parler d'un opéra signé Bob Wilson, sur une musique de Philip Glass ou d'une œuvre de Glass sur une mise en scène de Wilson ? Par solidarité vis-à-vis du projet initial, les co-auteurs sont demeurés solidaires à tel point que leur collaboration a été reconduite 3 fois avec succès (1976, 1984, 1992 et 2012).. Quelques productions récentes peinent à égaler la version originelle, telles celles plus récentes dues à Achim Freyer (1988) et Susanne Kennedy (2023), celle-ci bien trop surchargée pour ne pas dire franchement "kitsch". Cela dit, la musique de Glass est assurée de conserver sa radicalité primitive indépendamment de toute mise en scène particulière et, à ce titre, elle est prête pour entrer au répertoire y compris en version de concert comme l'ont prouvé récemment les ensembles néerlandais Attacca et surtout belge Ictus & Collegium vocale Gent.
La musique d'Einstein on the Beach a clôturé la première période compositionnelle de Glass : celles du maxi-minimalisme radical déjà développé dans le manifeste fondateur, Music in Twelve Parts.
Note : c'est à dessein que je parle de maxi-minimalisme quand tant de commentateurs parlent de simple minimalisme. La structure globalement répétitive de la musique de Glass première manière est en effet continuellement ponctuée de micro variations qui ne cessent de compliquer la tâche des valeureux interprètes et des auditeurs attentifs. Si cette musique n'était que répétitive, il serait possible d'en compresser la partition en mentionnant les reprises or cela est radicalement impossible : l'économie de papier que l'on ferait de la sorte serait annihilée par l'obligation de détailler tous les micro changements.
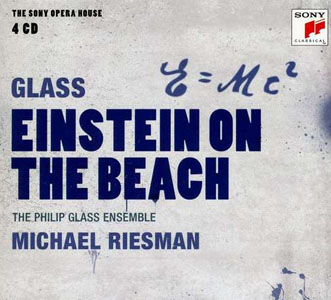
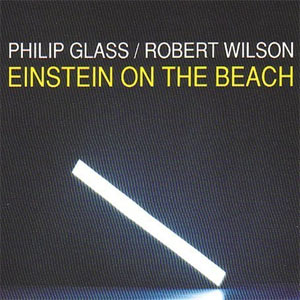
J'ai glané pour vous quelques extraits significatifs d'Einstein on the Beach, issus d'enregistrements de studio ou de concert : Knee 1, Trial, Night Train, Knee 3, Dance 2, Knee 4, The Spaceship, Knee 5. Quant au Knee 2, voici le solo qu'en fait le violoniste Tim Fain (Qui osera encore dire que cette musique est lassement répétitive ?).
Deux enregistrements d'Einstein sont actuellement en concurrence : le premier, édité chez CBS lors de la création avignonnaise, puis repris au catalogue Sony, est amputé de 45 minutes (en cause, la durée des disques vinyles de l'époque !). Le deuxième, édité chez Nonesuch en 1993, est complet et globalement de meilleure qualité surtout au niveau instrumental. Nul ne sait si un nouvel enregistrement suivra la reprise de 2012.
Programmé à Montpellier hors abonnement, Einstein a attiré un public jeune qui lui a fait un triomphe; cela devrait faire réfléchir nos organisateur de concert, confrontés au double problème du rajeunissement du répertoire et du public. On a plus d'une fois suggéré d'apprivoiser les "vieux mélomanes" en programmant une oeuvre contemporaine entre deux chevaux de bataille classiques mais ne pourrait-on faire l'inverse, au moins pour une série d'abonnement, essentiellement dédicacée à la jeune génération : intercaler une oeuvre classique entre deux oeuvres contemporaines "bien choisies" ? Je sais que le choix des oeuvres risque de poser des problèmes de conscience à nos gentils décideurs de programmes mais je sais également que Desert Music de Steve Reich, Grand Pianola Music de John Adams ou Itaipu de Philip Glass possèdent les ressorts dynamiques de nature à plaire à nos jeunes gens et je fais le pari que le succès serait au rendez-vous, même en insérant ici ou là un concerto de Mozart ou une symphonie de Beethoven. Chiche ?
Dans un souci de complétude, sachez que l'opéra multimédia a connu d'autres incarnations plus récentes parmi lesquelles j'épingle The Cave (1993) de Steve Reich et deux œuvres particulièrement réussies de Louis Andriessen, Writing to Vermeer (1998) et La Passione (2000).